|
LE CIEL SUR TERRE
La stratégie de Klaus Pinter d'une re-déconstruction
In: Rebonds. Une œuvre éphémère pour le
PANTHÉON par Klaus Pinter. Monum, Éditions du patrimoine,
Paris 2002, S.6-13. Wiederabdruck in: Kunstwissenschaft - Eine Art Lehrbuch.
Essen 2002

Deux énormes sphères ont été roulées
au Panthéon. Le sculpteur Klaus Pinter a ainsi placé la
forme géométrique la plus instable, mais aussi la plus
parfaite au sein même du «Temple des grands hommes»
: une sphère posée au sol, dans la croisée du transept
et une autre, suspendue, flottant dans le choeur. Le choix de cette
forme évoque l'histoire de l'esprit depuis Platon, qui dans le
Timée développa à partir des quatre éléments
le «Corps du Monde» dans sa forme sphérique. Involontairement
nous ressentons la sphère comme qualité idéale
et intemporelle, comme forme absolue, que nous ne voyons cependant que
de l'extérieur. A l'intérieur, sa surface lisse se soustrait
à toute perception claire.
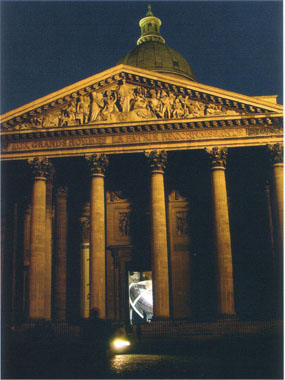
L'artiste a cependant un tout autre objectif que de mettre en avant
cette tradition idéaliste. Il tente l'aventure paradoxale d'évoquer
la sphère comme symbole de l'ère démocratique depuis
la revolution française, tout en la transformant simultanément.
En se portant sur l'environnement des sphères, leur cadre, leur
passe-partout architectural, le regard saisit ainsi le thème
de la perception.
Dans l'introduction de La théorie des 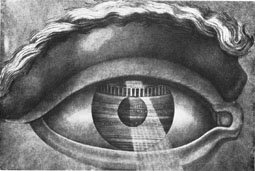 couleurs,
de J. W. von Goethe, se trouve une célèbre citation empruntée
au mystique Jakob Böhme: « Si I'œil ne ressemblait pas
au soleil, il ne pourrait jamais le voir ». Goethe luimême
se réfèrait à la lumière er non à
la forme. Il serait cependant irresponsable d'oublier qu'aux alentours
de 1800, l'esthétique semblait comme possédée par
la sphère. Non seulement la lumière intérieure
rencontre couleurs,
de J. W. von Goethe, se trouve une célèbre citation empruntée
au mystique Jakob Böhme: « Si I'œil ne ressemblait pas
au soleil, il ne pourrait jamais le voir ». Goethe luimême
se réfèrait à la lumière er non à
la forme. Il serait cependant irresponsable d'oublier qu'aux alentours
de 1800, l'esthétique semblait comme possédée par
la sphère. Non seulement la lumière intérieure
rencontre
la lumière extérieure dans l'œil, mais le globe oculaire,
lui méme de forme sphérique, ressemble formellement à
l'astre du jour.
Lorsque l'église Sainte-Geneviève fut transformée
en Panthéon en 1791, plusieurs 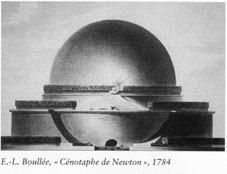 architectes
révolutionaires avaient déjà conçu depuis
longtemps quantité de maisons et monuments sphériques
vertigineux. architectes
révolutionaires avaient déjà conçu depuis
longtemps quantité de maisons et monuments sphériques
vertigineux.
Etienne-Louis Boullée (1728-1799) avait ainsi imaginé
dès 1784 son gigantesque cénotaphe d'Isaac Newton, qui,
grâce à la loi sur la gravité, avait expliqué
le mouvement des planétes autour du soleil.

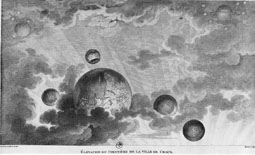 Claude-Nicolas
Ledoux (1736-1806) dessina dans Vision cet équilibre fluctuant.
Il réalisa avec Cimetière et surtout avec sa célèbre
Maison des gardes champêtres (1782) le prototype d'une
architecture angoissante, dont le haut et le bas étaient interchangeables.
Cette construction utopique devint dans La perte du Milieu (1948)
de Hans Sedlmayr, le témoin principal d'un diagnostic pessimiste
sur la modernité. Claude-Nicolas
Ledoux (1736-1806) dessina dans Vision cet équilibre fluctuant.
Il réalisa avec Cimetière et surtout avec sa célèbre
Maison des gardes champêtres (1782) le prototype d'une
architecture angoissante, dont le haut et le bas étaient interchangeables.
Cette construction utopique devint dans La perte du Milieu (1948)
de Hans Sedlmayr, le témoin principal d'un diagnostic pessimiste
sur la modernité.
Jean-Jacques Lequeu (1757-1825) fut lui aussi fasciné par les
possibilités qu'offrait la sphère à parvenir à
une égalité éternelle. Ses esquisses du Temple
de la terre et du Temple de l'égalité, réalisées
entre 1793 et 1794, en sont la meilleure preuve.
Le dessin Maison pour un cosmopolite d'Antoine Laurent-Thomas
Vaudoyer (1756-1846), publié en 1802 est un autre témoignage
de l'orientation cosmologique de l'architecture révolutionnaire.
L'architecture du Panthéon, en tant que monument funéraire
et commémoratif suivait une toute autre logique historique.
Deux siécles aprés sa construction, la corrosion de l'armature
des blocs de pierre (armature remontant à Jacques-Germain Soufflot,
1713-1780) menace à tout moment d'en faire tomber des morceaux
: - pour cette raison on ne peut plus pénétrer dans le
vaisseau central ou dans le transept - donc au centre du bâtiment,
sous la coupole. Les visiteurs, protégés par un filet,
ne peuvent ainsi que longer les barrières autour du «centre
perdu» de fait.
Le cercle est une métaphore parlante de la pensée, en
général, et de la pensée esthétique en particulier.
Jacques Derrida en fit d'ailleurs dans son livre La vérité
en peinture( 1978) une constante de son analyse déconstructiviste
des «quatre vérités de la peinture». Il y
rappela que Georg Wilhelm Hegel (1770-1891), lui aussi contemporain
des années révolutionnaires, en avait été
le précurseur. Et qui sera surpris d'apprendre que le mâitre
immédiat de Derrida, Martin Heidegger (1889-1976) avait lui aussi
eu recours au cercle dans De l'origine de l'œuvre d'art.
Derrida, lui, reste à la surface, car il se consacre à
la peinture. Le passe-partout devient chez lui le premier objet de ses
réflexions: «en ne cessant de se matérialiser, il
met en jeu sa carte, ou plutôt ici son carton, entre le cadre,
ou plus précisément la partie intérieure de celui-ci,
et l'extrémité extérieure de ce qu'il met en valeur.
Il fait ainsi ressortir, par son espace vierge, l'image, le tableau,
la forme, le système des traits et des couleurs». (La
vérité en peinture. 1978, Vienne, 1992/page 28).

Dans son «Intro-reduction», Derrida projète des cercles
diachroniques dans le cadre, tel un Astrolabe. De leur projection dans
l'espace naiît, implicitement, une sphère, forme idéale
de la pensée.
Dans le bâtiment même du Panthéon, cet espace est
accentué par les formes circulaires du dallage en pierre, conçu
par J.-B. Rondelet entre 1806 et 1809 (il avait décidément
le nom adéquat pour son projet).
La sphère de Klaus Pinter ne se trouve pas au centre exact du
Panthéon, c'est à dire sous le lanternon uniquement visible
de l'extérieur. Elle laisse libre cet endroit central pour que
l'on se souvienne de l'expérience scientifique qui bouleversa
la conception traditionnelle du monde, et qu'un roman d'Umberto Eco
rendit célèbre.
Louis Napoléon Bonaparte fit démonter en 1851 le célèbre
pendule de 43 kilos du physicien Léon Foucault et pendu à
un fil métallique de 67 mètres. Ce pendule avait été
construit pour démontrer, de façon visible, le mouvement
de rotation de la terre. La position quelque peu excentrée de
la sphère fait ainsi allusion à ce mouvement.
Si l'on ne peut, bien entendu, pas voir son intérieur, la surface
extérieure de la sphère n'est pourtant pas non plus l'objet
de la contemplation. Elle empêche au contraire d'admirer directement
la coupole. Mais il faut aussi avouer qu'elle reflète tout ce
qui se trouve au-dessus d'elle. Nous voyons ainsi, sur la surface de
la sphère, la voûte de la coupole, sans que cette dernière
ne se réfléchisse exactement. Le visiteur voit ainsi stir
la surface convexe de la sculpture, ce qui ne lui est pas permis d'admirer
directement.
Klaus Pinter est depuis toujours un destructeur: il bouleverse toujours
l'ordre rencontré par des interventions décoratives. Dans
les musées et dans tout bâtiment marqué par la patine
de l'histoire, il aime déconstruire volontairement la supposée
harmonie, et nous oblige ainsi à la remettre en question. Au
Panthéon il n'y a a pas uniquement deux sphères esthétiques,
l'une posée au sol et l'autre dans les airs : ces deux sphères
montrent bien plus ce qui est caché et dévoilent indirectement
le centre lumineux de  l'architecture
traditionnelle. Le regard vers le haut avait été, jusqu'à
la Révolution française, une évidence sociale:
d'en haut venait la lumière, la splendeur, la vérité,
la grâce, la richesse. L'Eglise et l'Etat avaient une organisation
pyramidale, jusqu'à ce que l'homme se redresse et mette un terme
à cet état voulu par Dieu. La sphère flottant dans
le chœur, tel un ballon, représente cette élévation.
Par la construction de leur dirigeable en 1783, les frères Etienne
Jacques et Michel Joseph de Montgolfier ont l'architecture
traditionnelle. Le regard vers le haut avait été, jusqu'à
la Révolution française, une évidence sociale:
d'en haut venait la lumière, la splendeur, la vérité,
la grâce, la richesse. L'Eglise et l'Etat avaient une organisation
pyramidale, jusqu'à ce que l'homme se redresse et mette un terme
à cet état voulu par Dieu. La sphère flottant dans
le chœur, tel un ballon, représente cette élévation.
Par la construction de leur dirigeable en 1783, les frères Etienne
Jacques et Michel Joseph de Montgolfier ont
été les premiers à se lancer à la conquête
du ciel. Les architectes de la Révolution ont fait leur ce ballon
pour le ramener sur la terre désormais transformée.
Odilon Redon: "E.A.Poe. L'œil
qui se dirige comme un ballon
bizarre vers l'infini", 1882
Le cercle s'impose à nous mentalement devant l'équilibre
ainsi ébranlé. Hegel avait ainsi, dans sa théorie
des formes, imaginé l'esprit objectif au-dessus de l'esprit subjectif
et l'esprit absolu comme ersatz philosophique de Dieu, tout en adoptant
trois étapes dans le développement de l'Idée :
l'art, la religion et la philosophie.
Le regard vers la coupole est désormais perturbé. C'est
bien là tout le secret du Panthéon : s'il est destiné
aux grands hommes, le simple mortel ne peut cependant que tourner autour
du centre, à cause de l'état matériel et architectonique
du bâtiment. Le visiteur ne peut se placer au cœur du bâtiment
et admirer cette splendeur verticale. Pinter rétablit ce rapport
en reconstruisant ce point de vue.
Un miroir ovale et reflétant directement la pièce, présenté
lors de l'exposition Wiener Mischung (Mélange viennois) à
la Hermes Villa de Vienne en 2000, avait déjà le même
but. Dans l'exposition actuelle, il utilise la forme symbolique qui,
aux alentours de 1800, avait ébranlé les hiérarchies
fondamentales des relations sociales.
La réflexion de la perspective à la surface de la sphère
montre non seulement l'espace caché à la vue, mais aussi
celui qui fut aussi perdu historiquement. Si la sphère a bouleversé
vers 1800 la vision er la perception des hommes, elle personnifie aujourd'hui
le passé. C'est le seul retour possible. Elle ne rétablit
pas par nostalgie la cour royale et son système de domination
verticale, er ne répète pas non plus le bouleversement
révolutionnaire. Au contraire, la sculpture, spécialment
crée pour le «cadre» du Panthéon, met en scène
l'image. La présentation cache ce qui est montré.
Lors de son exposition au Louvre en 1990 et intitulée «Mémoires
d'aveugle: l'autoportrait et autres ruines », Derrida thématisa
ce processus: il attira l'attention des histoiriens d'art sur le fait
que le peintre, lorsqu'il peint, ne peut voir son motif, et que même
le trait ainsi formé reste caché sous la main qui dessine.
Le tableau nait donc aveugle.
 A l'époque,
il présentait une A l'époque,
il présentait une 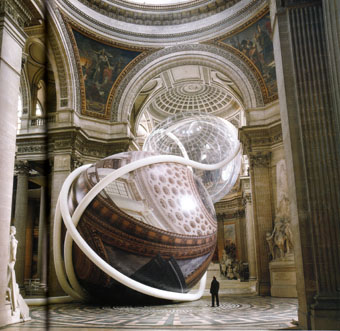 Allégorie
de l'œuvre de Jan Provost (1465-1529): le Christ er Marie portent
leur regard, comme le veut la tradition chrétienne, vers Dieu
le père et non vers la sphère entre terre et ciel, placée
au milieu du tableau. Le regard vers le ciel est devenu obsolète,
à moins que l'on ne s'intéresse à l'astronomie
ou au cosmos matériel. Pinter rétablit, grâce à
ses sphères, le lien historique perdu entre le spectateur et
le ciel, en le détruisant volontairement et en le laissant ainsi
à la réflexion. Allégorie
de l'œuvre de Jan Provost (1465-1529): le Christ er Marie portent
leur regard, comme le veut la tradition chrétienne, vers Dieu
le père et non vers la sphère entre terre et ciel, placée
au milieu du tableau. Le regard vers le ciel est devenu obsolète,
à moins que l'on ne s'intéresse à l'astronomie
ou au cosmos matériel. Pinter rétablit, grâce à
ses sphères, le lien historique perdu entre le spectateur et
le ciel, en le détruisant volontairement et en le laissant ainsi
à la réflexion.
(Traduction de Christophe Noblet)
|